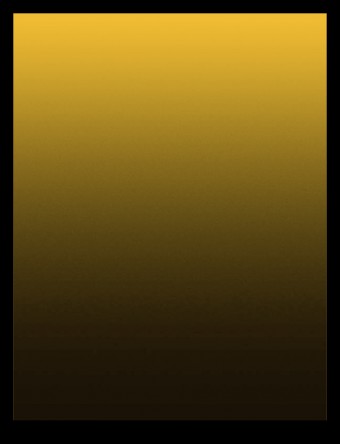Vertigo, la dernière œuvre du photographe suisse Yann Mingard, nous propose une lecture à la fois subjective et documentée de la dérive écologique du monde. Nous voici de plein fouet dans l’ère de l’Anthropocène. Les scientifiques justifient ce changement de période par la capacité cumulée des hommes — la nôtre — à outrepasser la puissance des forces telluriques. La définition de cette nouvelle ère repose sur des mesures physiques objectives, mais elle pourrait aussi bien se caractériser par le niveau vertigineux d’impunité et d’inertie des hommes face au désastre à venir — semblant confiner au déni de réalité. Jusqu’au milieu du XXe siècle les artistes ont été fascinés, presque béatement, par une nature sauvage et immaculée. Même si des questions éthiques ou politiques sous-tendent le travail de Yann Mingard, l’assujettissement, la beauté et la majesté des forces physiques ne sont pas absentes de ses images. Les aplats de matière, les couleurs, nous murmurent le grondement de cette terre en mouvement. Roland Barthes estimait l’attrait d’une photographie de paysage par sa capacité à donner envie au spectateur de s’y projeter, de l’habiter — c’était sans compter les paysages accidentés, irradiés, dystopiques. Que sont devenus les panoramas alpins si prisés des premiers photographes et des touristes asiatiques ? Yann Mingard nous entraîne de l’autre côté de la carte postale, vers les abysses, dans les entrailles des effondrements rocheux, des arbres arrachés et des laves torrentielles. Ses paysages à la limite de l’abstraction sont dénués d’un horizon susceptible de nous apaiser, ils nous montrent dans une inquiétante prophétie tantôt le ciel, tantôt la matière géologique (la terre, la roche, la boue), mais rarement les deux réunis — comme si, dégoûtés l’un de l’autre, ils refusaient dorénavant de se toucher. La terre est montrée éventrée, béante, sertie des cicatrices d’une bataille dont les principaux protagonistes sont absents. Invisible comme les particules fines en suspension dans l’air ou le rayonnement radioactif, la figure humaine n’apparaît que sous la forme d’étranges pantins à la recherche d’une ogive nucléaire égarée dans le permafrost. En 1678, bien avant la première révolution industrielle, en appelant à Dieu en ultime recours, les habitants du petit village de Fiesch, en Suisse, écrivirent au pape afin qu’il bénisse leur prière destinée à endiguer la progression du glacier d’Aletsch et épargner leur village. Exaucés au-delà de toute attente, ils le supplient aujourd’hui d’inverser la prière et de freiner la fonte inexorable du plus grand glacier d’Europe. Hors champ, l’empreinte humaine recouvre totalement la scène du crime. Mû par son appétit de confort et une foi intacte en la technologie comme ultime sauveur, l’homme continue sa marche. Dans les carottes de glace qu’il étudie soigneusement, il est capable de discerner les variations climatiques sur des millénaires. Les bulles d’air enfermées dans la glace sont autant de capsules d’histoire, dévoilant une à une les secrets du temps. L’animal n’est lui non plus jamais représenté directement par l’artiste. Meurtri dans sa diversité, il apparaît comme une réminiscence pariétale — un fantasme entre un futur improbable et un lointain passé, qui pousse certains scientifiques à vouloir, dans un moment d’épiphanie technologique, courtiser la science-fiction en ressuscitant le mammouth à partir d’ADN découvert dans la banquise. Les pachydermes géants repeupleraient la toundra et leur présence compenserait l’émission de gaz à effet de serre… L’histoire humaine a rendez-vous avec l’histoire de la Terre.